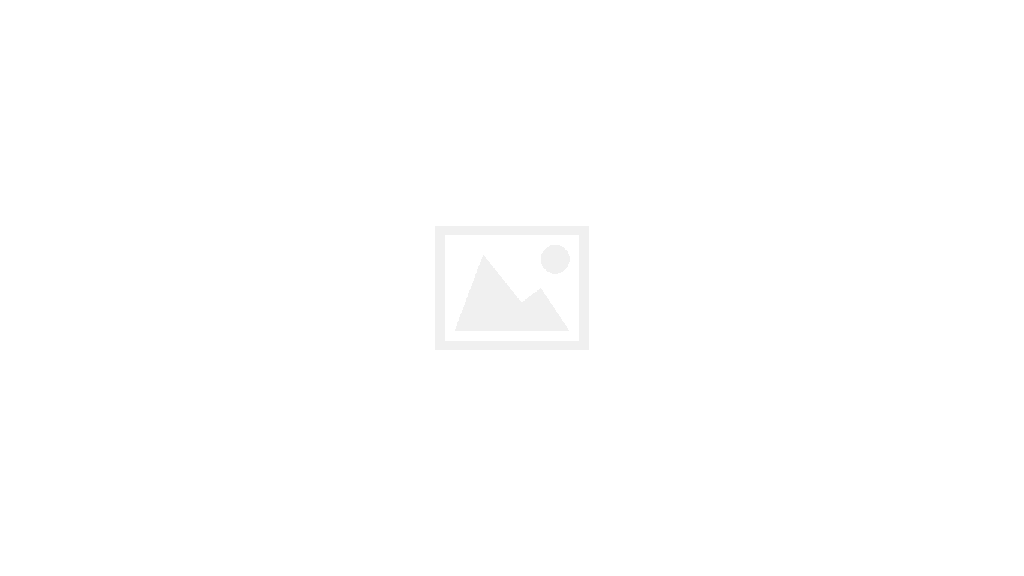Par Erwin le 17.06.2021
L’un des membres du jury de cette année l’a prédit : d’ici une dizaine d’années, le Festival du Film Subversif de Metz, porté par la passion, la fraîcheur, l’enthousiasme et la sincérité de ses organisateurs, ses bénévoles et son public, deviendra un jalon, une référence incontournable parmi les nombreux festivals de cinéma hexagonaux, voire mondiaux. Nous prenons le pari qu’il lui faudra moins de temps que cela.
Du 9 au 13 juin 2021, nous avons pu assister à une partie des projections proposées, dont 4 des 5 films en compétition officielle, dont la qualité, à notre goût, allait crescendo.
Shiva Baby, d’Emma Seligman.
Nous nous attendions à un film indien qui parlerait d’une jeune fille influencée par la déesse Shiva, mais le titre fait en réalité référence à l’introduction incongrue d’un bébé dans une réunion post-funérailles d’une communauté juive américaine. La jeune protagoniste Danielle est une étudiante poussive, paumée et sans véritable avenir, écrasée par le poids des traditions de sa culture qui condamne sa bisexualité et de sa famille qui scrute le moindre de ses gestes dans la crainte d’un nouveau dérapage qui attirerait sur eux une honte terrible. Elle entretient avec un homme plus âgé une relation monnayée qu’elle prétend banale mais pense exclusive, et voit ses espoirs détruits quand l’amant en question lui est « présenté », avec sa belle et brillante épouse et leur bébé, lors de la fameuse shiva.
Le film se laisse suivre sans déplaisir ni ennui, on rit parfois, l’interprétation est bonne, et sa fin philosophique est plutôt bien sentie. Attention, gros spoiler :
Danielle, sa famille, son ancienne maîtresse, son amant avec femme et enfant, se retrouvent tous dans un van conduit par son père -l’excellent Fred Melamed, qui annonce qu’il va déposer la grand-mère en premier. Comprendre, peut-être, comme le rappelait le carton final de Barry Lyndon, que tout ce petit microcosme finira par s’éteindre, à commencer par les anciens, et que les différences et les marivaudages n’ont pas tant d’importance que ça. Une autre lecture étant que le vieux monde s’en va et que ce qui était vertement condamné sera désormais toléré : Danielle tient en effet la main de la fille avec qui elle avait jadis fauté.
Mosquito State, de Filip Jan Rymsza
« Août 2007. Richard Boca, un analyste de Wall Street qui réside seul dans un appartement luxueux avec vue imprenable sur Central Park, exploite sans relâche des données financières et commence à avoir de sinistres visions. Ses modélisations informatiques se comportent de manière désordonnée alors que des nuées de moustiques envahissent son penthouse. Ces manifestations étranges commencent à jouer sur sa santé mentale… »
Mettre en parallèle le moustique, un suceur de sang invasif sans morale ni regrets, avec les traders de Wall Street qui ont précipité la chute de l’économie mondiale en 2007-8 semble une idée évidente, curieusement peu exploitée jusqu’ici. Voilà chose faite, avec un certain goût esthétique et une mise en scène onirique plutôt séduisante. Après un très beau générique qui décrit les divers stades de croissance du moustique, de l’œuf à l’adulte, le film est divisé en séquences qui reprennent chacun de ces stades pour illustrer la transformation/résignation de Richard Boca. S’agissant d’une allégorie, chacun est libre d’y voir ce qu’il entend, et ce qu’il entend, d’ailleurs, est généralement la stressante vibration des ailes de ces petits nématocères (ce mot a été googlé, rassurons-nous), qui constitue une grande partie de la bande-son du métrage. Nous y avons vu la fin d’un monde et l’avènement de deux administrations successives et contradictoires, Obama et Trump, l’un tentant de redresser l’économie, l’autre faisant des pâtés de sable avec les miettes de son quatre-heures. Là encore, chacun est libre de décider lequel a fait quoi.
Une vie démente, de Ann Sirot et Raphaël Balboni
Quand le Belge est bon, le Belge est très bon. Prenons Brel. Prenons Stromae. Prenons Bouli Lanners, André Franquin, Hergé. Prenons la Leffe. Reprenons une Leffe.
Prenons Sirot et Balboni, et leur premier long-métrage. Dès la scène d’ouverture, confondante de naturel, on est en empathie totale avec ce jeune couple, Noémie et Alex (Jean Le Peltier, sorte de sosie de James Franco), on sourit, puis on rit, puis on se gondole franchement. Ils voudraient avoir un enfant mais ne savent pas trop comment s’y prendre pour maximiser leurs chances et s’adressent, face caméra, à une interlocutrice invisible qui doit les conseiller. Ces « talking heads » unilatérales reviendront d’ailleurs souvent dans le film, face à un banquier, un médecin ou autre.
Vient la mère d’Alex, brillante galeriste mondaine tout en papillonnage et en maîtrise, qui commence très subrepticement à perdre cette même maîtrise. On lui diagnostique une démence sémantique qui va inexorablement la faire sombrer vers un abîme de confusion, et là, attention, terrain glissant. Quand on tâte Alzheimer, on risque la douloureuse comparaison avec des œuvres magnifiques telles que Still Alice ou le récent The Father. Ce qui est fait n’est plus forcément à faire. Or, puisque nous sommes dans une comédie, l’angle d’approche est radicalement différent et cela fonctionne parfaitement. Le mal qui ronge Suzanne n’est jamais traité à la légère, on comprend très bien la lourdeur de ses conséquences sur la vie de sa première victime, bien entendu, mais également sur celle de son entourage immédiat : son fils et sa belle-fille, dont les vêtements et les meubles prennent peu à peu, dans certaines scènes de débrief, le motif envahissant d’un couvre-lit qu’elle leur a offert. Malgré tout, on rit. Maman n’est bientôt plus apte à mener une vie solitaire et l’on organise un (hilarant) casting pour trouver l’aide à domicile qui s’occupera d’elle. Contre toute attente, c’est un gros ours hardos qui obtient le job et qui fera un travail formidable et touchant de compassion et de patience pour cette femme qui retourne progressivement en enfance, avec ses caprices, ses incohérences et son incapacité à se concentrer sur une seule chose à la fois.
Vient la phase médicamenteuse provoquée par une trop grande lassitude du couple qui vacille dangereusement sur ses fondations ; de maniaque, Suzanne passe à dépressive, ce qui plombe encore plus l’ambiance. Il s’agira alors de trouver le bon dosage du traitement pour lui assurer une dernière ligne droite paisible, près de ses enfants et, peut-être, de ses petits-enfants.
Tout n’est pas parfait dans le film, on peut reprocher quelques longueurs dans la répétition des scènes de manie. Cependant, si Sirot et Balboni ne sont peut-être pas encore Brel ni Franquin, nous ne manquerons pas de suivre leur carrière, car ils sont diablement prometteurs.
The Show, de Mitch Jenkins, écrit par Alan Moore.
Nous ne créditons généralement pas les scénaristes, car l’auteur d’un film est traditionnellement le réalisateur, mais nous avons ici affaire à l’un des plus grands auteurs de romans graphiques du XXe et du XXIe siècles, célébré partout dans le monde pour la magnificence de son génie. C’est dire si son premier scénario de cinéma était attendu, et c’est dire si l’on craignait une franche déception. A trop regarder le soleil, on peut avoir du mal à distinguer la délicatesse de ce que l’on nous montre ensuite.
Autant le dire tout de suite : nous n’avons pas été déçus une seule seconde. Si nous avions été juré, nous lui aurions tout simplement décerné le Grand Prix.

Nous sommes assez loin de Watchmen, même si l’affiche du film en reprend les codes graphiques, sans doute pour attirer un large public. Quitte à faire des comparaisons, on se sentirait presque parfois chez Lynch, version Northampton. Nous serions tentés de résumer l’histoire mais nous avons pris tellement de plaisir à découvrir tout cela au fur et à mesure que nous préférons de pas gâcher l’expérience de nos lecteurs. Si vous avez une sensibilité comparable à la nôtre, sachez que vous rirez fréquemment, que vous retrouverez cette atmosphère et ce ton tellement britanniques que l’on trouve dans certaines séries de la BBC, que vous rencontrerez une galerie de personnages tous plus délirants, drôles et intéressants les uns que les autres, que vous serez constamment surpris et qu’il est inutile de chercher à anticiper l’intrigue. Moore se paye même le luxe d’interpréter -et plutôt très bien- l’un des rôles-clés de l’histoire, cet homme doré à tête de lune qui… Nous en avons déjà trop dit.
Attention, tout n’est pas forcément limpide. Nous laissons encore le film se répandre dans notre mémoire afin d’y trouver quelques clés, notamment le rôle d’un personnage que nous n’avons tout simplement pas compris, mais cela fait partie du plaisir. Tout n’est pas offert sur un plateau avec explication de texte, il faut bosser un peu, il faut mériter le bonheur que l’on a reçu durant ces deux heures. En fait, il faut fermer les yeux et comprendre ce que la persistance rétinienne projette sur nos paupières. Comme après avoir regardé le soleil, exactement.
Autres aspects du festival
Chaque film était précédé d’un message vidéo de ses créateurs, qui regrettaient tous de n’avoir pas pu faire le voyage pour des raisons sanitaires, ainsi que du clip d’un morceau de musique à découvrir. Deux sortaient véritablement du lot : Miel, par November Ultra (quelle voix !), et A Room with a View, par Rone (mais quel clip dingue !), que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre. Attention, l’un des danseurs du deuxième clip a les cheveux longs dans la nuque, vous êtes prévenus.
Nous ne nous étendrons pas sur ce que nous n’avons pas eu l’occasion de voir, à notre grand regret (les reprises du Roi et l’Oiseau, de La Planète Sauvage, d’Eraserhead, de The Amusement Park et de THX 1138, le ciné-concert Darkstar, la soirée Del Toro qui proposait ses deux meilleurs films, les courts-métrages…). Par contre, voir sur grand écran deux des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma de SF que nous ne connaissions que par la vidéo, Alien et Planète Interdite, fut une expérience vraiment stimulante.

Nous avons pu voir deux très bons documentaires, d’abord Sisters with Transistors, de Lisa Rovner, qui revient sur toutes ces femmes formidables qui ont inventé la musique électronique (ça parle de thérémine et de sirènes annonçant les bombardements du Blitz comme sources d’inspiration, c’est franchement à voir), et ensuite Feels Good, Man, d’Arthur Jones, terrifiant film sur l’accaparation de l’inoffensive grenouille dessinée Pepe The Frog par une bande de nazis décérébrés, pardon pour le pléonasme, et qui a heureusement une fin positive. Nous avons également pu assister à l’extraordinaire conférence de Pilar Revuelta, décoratrice oscarisée ayant travaillé sur des films de Del Toro, Soderbergh, Ridley Scott ou Almodóvar, et qui nous a passionnés de la première à la dernière seconde de sa « masterclass » avec ses explications, anecdotes, réflexions et sa tchatche espagnole caliente tellement attachante.
Enfin, une jolie petite expo est revenue sur l’insensé et mythique Festival de Science-Fiction de Metz, qui a vécu de 1976 à 1986 sous l’impulsion de Philippe Hupp et grâce auquel votre serviteur a eu le grand privilège d’user ses culottes sur les sièges des cinémas aujourd’hui disparus. Rappelons tout de même que le gigantesque Philip K. Dick est sorti une seule fois des Etats-Unis, et c’était pour répondre à l’invitation du festival, au cours duquel il a donné une conférence dantesco-mystique qui a changé sa vie. Comme on dit, those were the days…
Those days are un peu back grâce à cet excellent festival. Pour la deuxième fois (nous étions également présents en 2019), nous lui souhaitons un parfait avenir.
PALMARES
Les prix des jurys pour les courts-métrages en compétition ont été attribués à :
– « Peut-on se comprendre en parlant ? » de Nathan Ghali (jury jeune).
– « Sticker » de Georgi M. Unkovski (jury professionnel).
Tandis que les prix des meilleurs long-métrages sont attribués à :
– « L’indomptable feu du printemps » de Lemohang Jeremiah Mosese (jury jeune)
– « Shiva baby » de Emma Seligman (jury professionnel).
Avec une mention spéciale du jury professionnel pour le film « L’indomptable feu du printemps » de Lemohang Jeremiah Mosese et le court-métrage « Acadiana » de Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin.